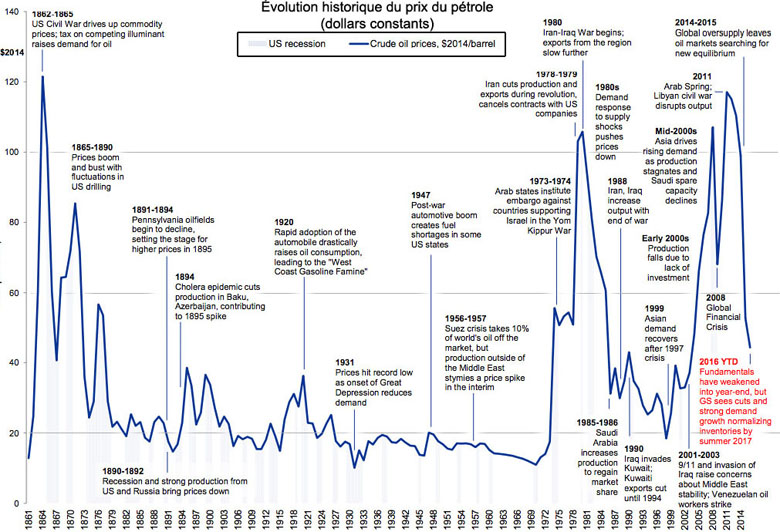Au tout début de l’exploitation
des ressources minérales, l'humanité a commencé par tirer du sol les plus
faciles à extraire et les plus concentrées, celles qui notamment apparaissaient
en affleurement. À cette époque lointaine, la collecte de pépites de cuivre
natif, ou d'autres métaux (or, argent, étain, zinc, etc.) a eu un impact
environnemental nul.
Quand on exploite une mine, souterraine ou à ciel ouvert, il y a un rapport entre la masse à excaver et la masse de substance récupérée après concentration et séparation finale:
Quand on exploite une mine, souterraine ou à ciel ouvert, il y a un rapport entre la masse à excaver et la masse de substance récupérée après concentration et séparation finale:
- au début de l'âge de bronze (cuivre + étain), le
"mirerai" titre ~ 90%; ex. Fig.1 ci-contre:
- en 1800,
teneurs exploitées: 10 %
- en 1900,
teneurs exploitées: 3 %
- en 1930,
teneurs exploitées: 2 %
- en 1975,
teneurs exploitées: 1 %
- en 2015, teneurs exploitées: 0,5 %
N.B. Ces valeurs donnent une indication de la moyenne des teneurs exploitées; les teneurs commercialement exploitables varient beaucoup d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre selon les contextes géologiques et géopolitiques. La figure ci-dessous donne en graphique l'évolution de ces teneurs au cours des derniers siècles du cas du cuivre:
Figure
2 Évolution historique dans la teneur
des minerais de cuivre de 1770 à 2010 (WikiMedia).
La raréfaction des gisements de bonne concentration, fait augmenter le prix de la substance (le cuivre dans notre exemple). Cette augmentation de la valeur du métal rend alors possible l'exploitation de teneurs plus faibles (fig. 2); il en coûte plus cher de tirer une tonne de cuivre en excavant, transportant, traitant 200 tonnes de roc plutôt que seulement 20 tonnes (fig. 3). L’évolution des techniques joue également un rôle pour rendre rentable l’exploitation de concentrations de plus en plus faibles.
Figure 3 Effet
de la teneur sur le volume d'impacts environnementaux créés.
L'économie minière ne tient compte ici que des coûts de production; on oublie depuis toujours dans l'équation, les coûts environnementaux. Or dans le cas b) (fig. 3) il y a évidemment un trou énorme laissé dans le paysage; il y a aussi dix fois plus de déchets miniers concassés, qui dans le cas du cuivre comportent beaucoup d'éléments chimiques dorénavant soumis à la lixiviation. Il y a donc un impact de pollution dix fois plus grand en b) que dans le cas a).
Y a-t-il une limite dans cette
course qui se dirige vers des exploitations à des teneurs de plus en plus
marginales ? Est-ce que la raréfaction de la ressource et l'augmentation
conséquente de la valeur du métal pourra à lui seul maintenir indéfiniment
cette fuite en avant ? Est-ce envisageable d'ouvrir des sites miniers avec des
teneurs à 0,01% où on produira 10,000 tonnes de déchets pour affiner une tonne
de métal? La réponse est évidemment non: tôt ou tard les coûts
environnementaux, même si on essaie de les ignorer, deviennent incontournables.
Pour les hydrocarbures,
l'évolution historique est comparable. On est passé du pétrole jaillissant
facilement des puits dans les très bons gisements conventionnels au début du
vingtième siècle, à des gisements où le pétrole et le gaz sont de plus en plus
difficiles et très coûteux à extraire. Par
contre ce n'est pas la notion de teneur qui définit la qualité décroissante des
gisements; c’est plutôt une série de facteurs où l'impact environnemental
augmente dans le temps. On peut simplifier l'image générale de l'évolution dans le temps (1 -> 2 -> 3 -> 4) des
gisements d’hydrocarbures au cours du dernier siècle et demi:
1-
gisements conventionnels en milieu terrestre
↘︎ 2-
gisements conventionnels en milieu marin
↘︎ 3-
gisements marginaux: pétrole dégradé (sables bitumineux), roches très peu
perméables, gisements petits avec un réservoir fragmenté (gisements où le
pétrole et le gaz se retrouvent dans des petits réseaux de fractures, etc.)
↘︎ 4-
gisements non-conventionnels ou gisements de roche-mère (shales très
imperméable inexploitables autrement qu'en fracturant toute la masse rocheuse
qui emprisonne les microbulles d'hydrocarbures).
Les coûts d'extraction augmentent
avec le recours à des techniques de plus en plus invasives: du simple forage
avec pompe à piston classique on passe à des techniques de stimulation plus coûteuses
en énergie (vapeur pour mobiliser le pétrole visqueux des sables bitumineux),
stimulation chimique (acide concentré pour élargir la fissuration),
fracturation hydraulique dans certains gisements marginaux, ainsi que dans
tous les gisements d’hydrocarbures de roche-mère.
À la place de la notion de teneur, il est primordial de considérer
le facteur EROI : c'est l'énergie retournée dans une exploitation par
rapport à ensemble des énergies dépensées pour arriver à extraire (exploration,
forage, production). On pouvait extraire entre 100 et 1200 barils de pétrole au
début du 20e siècle en ne consommant que l'équivalent d’un baril (carburant
total requis pour le forage, le pompage, le traitement et le transport du
pétrole extrait). Un EROI de 100 est chose révolue depuis longtemps. La qualité
décroissante des gisements restants, l'obligation d'aller plus profond sous
terre, plus loin, en mer, etc. ont fait baisser l'EROI tout au long du siècle
dernier. La valeur moyenne en 1972 était rendue à 20. L'EROI est maintenant
particulièrement bas pour les derniers gisements mis en production: une valeur aussi
faible que 5 dans la mise en production de gisements marginaux et de gisements
de roche-mère dans le shale pour la période 2005 - 2012.
Ce sont les deux chocs
pétroliers à trente ans d'intervalle (voir fig. 4, 1980 et 2010) où le prix du
baril a dépassé pendant quelques années 100U$ qui ont mené à explorer et à mettre
en production des gisements de plus en plus marginaux.
Figure
4 Évolution historique du prix du
pétrole en dollars constants (source Holodny 2016).
Un EROI bas signifie qu’il faut recourir à des techniques envahissantes, coûteuses et polluantes pour un rendement devenu marginal. À une valeur de 3 (i.e. consommer une unité d'énergie pour en produire trois) le bénéfice brut d'extraire la ressource est presqu'annulé par les coûts d'exploitation. En même temps l'impact environnemental est maximal, car il est beaucoup plus étendu (fig. 5 b) pour chaque unité de substance utile produite. Si l'investissement économique avait à quantifier l'ensemble des coûts environnementaux au même titre que les coûts bruts d'exploitation, on arriverait vite à la conclusion qu'il n'y a aucun bénéfice net pour la société dans les gisements marginaux et dans les gisements de roche-mère. C'est d'ailleurs à cette conclusion qu'en est arrivée l'étude du BAPE sur la question du gaz de schiste en 2014. Anticosti aurait été un gisement encore plus déficitaire, avant même d'ajouter les coûts environnementaux.
 |
Figure 5 Grandes différence de volumes de roc impliqué dans les gisements conventionnels VS non-conventionnels (adapté de BC Petroleum & Natural Gas Geoscience). |
Une valeur élevée au baril
(>100U$) est très probablement chose du passé, sauf des exceptions ponctuelles dans des circonstances très particulières, car la demande stagnera et
déclinera dans l’avenir selon bien des spécialistes. Les
conditions géologiques au Québec ne permettraient hypothétiquement que de
démarrer des productions marginales, celles avec un EROI très faible, celles
aussi où les coûts environnementaux encore très mal comptabilisés seraient les plus élevés. On commence à peine ailleurs à mesurer le coût des puits abandonnés.
Les fuites de ces anciens puits constitueront encore longtemps des casse-têtes
insurmontables. On a révisé tout récemment (GIEC 2013) à
86 la valeur du potentiel de réchauffement climatique du méthane. C'est encore
plus récemment qu'on a commencé à publier des données sur la proportion des
puits qui laissent fuir du gaz. Ces fuites affectent tous les types de puits
sans exception: les sites d'exploration (ex. cas du Québec),
les sites de stockage (étude D.R Michanowicz et al. 2017) et les sites de production. L'impact de ces émissions de gaz devra tôt ou tard
être pris en compte à son vrai coût.
Bien des chercheurs reconnus
estiment que l'impact environnemental des puits dans les gisements marginaux et
dans les gisements de roche-mère vont dépasser les impacts des gisements
conventionnels. Cela tient à trois éléments nouveaux: 1) les techniques de stimulation et de fracturation nécessitent des
quantités considérables de produits chimiques à injecter dans le roc. Une
partie encore inconnue de ces substances va remonter lentement vers
l'écosystème de surface (les nappes phréatiques, les sols, l'atmosphère). 2)
Le milieu géologique est fortement modifié de façon irréversible par la
fracturation hydraulique; cette modification est essentiellement une
augmentation très considérable de la perméabilité du milieu, par conséquent des
voies de circulation pour les fluides (gaz et liquides). 3)
Les taux de récupération des hydrocarbures sont très bas dans les gisements
marginaux et dans les gisements de roche-mères : 1 à 2% pour le pétrole - 8 à 15% pour le gaz. Une partit importante des hydrocarbures
encore en place à la fermeture des puits finira à moyen terme (10 à 50 ans)
par trouver des voies vers le haut, par les puits corrodés ainsi que par le réseau de
la fracturation naturelle.
Il y a plusieurs études qui
montrent des effets sur la santé des populations et des écosystèmes voisins des
exploitations de gisements non conventionnels; cependant on connait encore très mal l'ampleur
des impacts réels de ces contaminations, car elles ne surviendront
principalement qu'après l'abandon des puits.